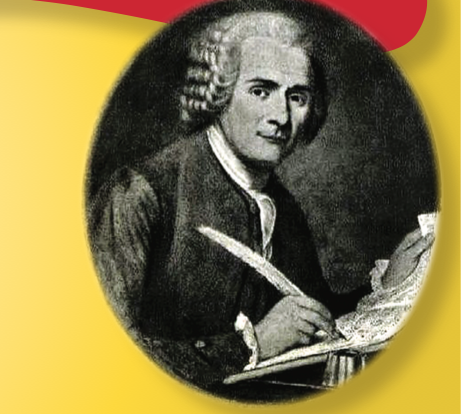Jean-Jacques Rousseau a joué un grand rôle dans la propagation des idées nouvelles dans les milieux éclairés de la société polonaise. Bien que n’étant jamais allé en Pologne, il avait identifié les problèmes qui minaient l’Etat polonais. S’agissant de la manière très particulière dont était composée la société polonaise, Rousseau mettait en évidence au chapitre VI de son essai que « la nation polonaise est composée de trois ordres : les nobles qui sont tout ; les bourgeois qui ne sont rien ; et les paysans, qui sont moins que rien. » Tout était dit.
En 2012, l’ambassade de Suisse en Pologne avait mis en avant les écrits politiques de notre compatriote au moment des célébrations du 300e anniversaire de sa naissance. J’avais eu l’honneur de présenter les « Considérations sur le gouvernement de Pologne », un écrit publié à titre posthume et réédité pour l’occasion chez Slatkine à Genève.
Pour Rousseau, imaginer l’écriture d’un projet de constitution n’était pas nouveau. Il avait déjà rédigé en 1765 un tel projet pour la Corse à la demande d’un patriote, l’aristocrate Corse Matthieu Buttaforo, proche de Pascal Paoli. Pourquoi la Pologne ?
A la mort du roi Auguste II dit « Le Fort », prince électeur de Saxe en 1733, l’Europe est à feu et à sang. Ce qui est en jeu, c’est la succession au trône de Pologne. La guerre durera de 1733 à 1738. L’Empire germanique et la Russie soutiennent le prétendant de Saxe, futur Auguste III, la France pour sa part soutient Stanislas Leszczinski dont la fille Marie Leczczinska a épousé le roi Louis XV.
Après de multiples péripéties qui voient les deux compétiteurs accéder au trône puis en être dépossédés par la force des baïonnettes et des intrigues de cour et d’argent, l’une n’allant pas sans l’autre, le conflit se termine par la victoire du prétendant de Saxe appuyé par la Russie lequel prétendant monte sur le trône sous le nom d’Auguste III. Stanislas Leszczinski reçoit quant à lui en guise de compensation, le duché de Lorraine qui reviendra à la France à sa mort. En 1764, à Varsovie, Stanislas-Auguste Poniatowski succède à Auguste III. Sous son règne, le rayonnement académique, culturel et artistique de la Pologne se caractérise par un essor remarquable. En revanche, le roi, qui avait été l’amant de la Grande Catherine devient insensiblement l’otage du parti pro-russe, ce qui provoquera en 1768 la révolte d’une partie de la noblesse polonaise réunie en Confédération, désireuse de s’opposer aux prétentions de la Russie sur le royaume de Pologne et qui proclame la déchéance du souverain. Cette insurrection (en France on appellerait ça une Fronde), prend le nom de Confédération de Bar du nom d’une localité située aujourd’hui en Podolie, Ukraine occidentale.
A l’issue d’une guerre civile dont les effets sont dévastateurs, la Confédération, est vaincue en 1772. C’est pour la Pologne le début d’une lente descente aux enfers qui se traduira par les trois démembrements du pays par les puissances voisines, Russie, Autriche et Prusse, conduisant purement et simplement à la disparition de l’Etat suite aux partages de 1772, 1793 et 1795.
C’est dans le contexte du soulèvement de la Confédération de Bar que Rousseau est approché par le comte Michel Wielhorski, venu en France en 1770 pour solliciter l’appui du royaume de France au profit des Confédérés. A cette époque, Rousseau réside à Paris, rue Plâtrière, à proximité du Louvre. Ses positions philosophiques en faveur de la liberté, du républicanisme et du patriotisme sont connues depuis la publication en 1762 « Du Contrat social », sans omettre son « Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes » publié en 1755.
Rousseau répond favorablement à la demande du comte Wielhorski et accepte de rédiger comme un consultant le ferait aujourd’hui, un texte constituant le socle d’une nouvelle charte fondamentale adaptée à une Pologne nouvelle, purgée de ses vieux démons car depuis plusieurs siècles en Pologne, l’anarchie a quasiment été érigée en fondement de l’organisation de l’Etat, soit Etat sans autorité unique et une organisation sans pouvoir politique suprême. Le projet de Rousseau est ambitieux puisqu’il postule que la société polonaise évolue à un niveau qui permette l’émergence d’une certaine forme d’égalité politique inspirée du Contrat social. Pour lui, la notion de souveraineté du peuple est indissociable de celle d’un système politique qui soit au service de l’intérêt général. Tel est le concept qu’il tente de modérer et d’adapter dans ses propositions destinées aux insurgés Polonais. Dans cette esquisse de modèle politique, Rousseau puise son inspiration dans son propre vécu.
Ses références sont celles de sa patrie genevoise, à savoir le Conseil général, Corps souverain, assemblée des citoyens et des bourgeois. C’est un modèle que voit les individus obéir à la loi et au législateur, entité centrale pour Rousseau. Chaque individu met en commun sa personne sous la suprême autorité de la volonté générale. Rousseau fait également à réitérées reprises référence à la Suisse en matière économique et financière lorsqu’il évoque notamment les dépenses publiques et l’égalité des fortunes au chapitre 11 de son essai.
Si pour Rousseau, c’est dans le peuple souverain que s’incarne la source première du pouvoir, il reconnait néanmoins que «la nation polonaise est différente de naturel, de gouvernement, de mœurs, de langage, non seulement de celles qui l’avoisinent mais de tout le reste de l’Europe. » Au fil des pages des « Considérations sur le gouvernement de Pologne « , on retrouve en permanence en filigrane, la philosophie du Contrat social.
Dans le projet constitutionnel proposé par Rousseau aux Polonais la notion d’amour de la patrie revient aussi fréquemment. Pour lui, cette notion est fondamentale. Elle constitue un creuset qui permet de fédérer les êtres et les énergies. La manière dont Rousseau perçoit la Pologne et son destin en Europe est étonnante et l’aspect visionnaire de son texte n’échappera à personne. J’en veux pour preuve ce passage: « Vous aimez la liberté, vous en êtes dignes, vous l’avez défendue contre un agresseur puissant et rusé qui, feignant de vous présenter les liens de l’amitié, vous chargeait des fers de la servitude. Maintenant, las des troubles de votre patrie, vous soupirez après la tranquillité ; je crois fort aisé de l’obtenir ; mais, la conserver avec la liberté, voilà qui me paraît difficile. » (1)
Cette autre exhortation n’a pas pris une ride : « Laissez donc votre pays tout ouvert, somme Sparte ; mais bâtissez-vous de bonnes citadelles dans le cœur des citoyens. » Là, Rousseau, se mue en stratège et rejette l’idée de construire en Pologne des forteresses et des citadelles édifiées avec d’imposants murs de pierre et coûtant fort cher, qui peuvent une fois occupées par un envahisseur, contribuer à opprimer la population. « Se bâtir des forteresses dans le cœur des citoyens », c’est ce qui a permis à la Pologne de préserver ce que l’historien Daniel Reichel a appelé « la substance du peuple. » (2)
Nous découvrons ici un Rousseau qui se préoccupe des moyens de défense de la Pologne. Il rejette fermement pour la Pologne, le modèle des troupes soldées ou d’une armée de métier appliqués au sein des grandes puissances européennes de ce temps. Ce faisant, il puise à nouveau son inspiration dans son vécu genevois. Il écrit par exemple : « Il faut remettre l’Etat militaire dans le même honneur où il était jadis, et où il est encore en Suisse et à Genève où les meilleurs Bourgeois sont aussi fiers de leur corps et sous les armes qu’à l’hôtel de ville et dans le Conseil Souverain. » Et de continuer : « Pour cela, il importe que dans le choix des officiers, on n’ait aucun égard au rang, au crédit, à la fortune, mais uniquement à l’expérience et au talent. J’ai vu le temps qu’à Genève, les Bourgeois manoeuvraient beaucoup mieux que des troupes réglées. » (3)
En 1774, Rousseau prend fort mal le fait que contre sa volonté, Wielhorski ait distribué sous le manteau, sans autorisation de sa part, un certain nombre d’exemplaires du texte. Leurs rapports s’en ressentent. Il manifeste sa mauvaise humeur et la citation suivante extraite d’une correspondance l’illustre bien :
« Je ne puis assurément approuver la conduite du comte Wielhorski à mon égard. Mais cet article à part que je n’entreprends pas d’expliquer, j’ai toujours regardé et je regarde encore ce seigneur polonais comme un honnête homme et un bon patriote. »
C’est Pierre-Alexandre Du Peyrou, patricien neuchâtelois fortuné, ami de Rousseau, par ailleurs son légataire particulier, qui prend l’initiative de publier à Genève la première édition complète de ses œuvres. Sous le titre : « Collection complète des œuvres de J.J. Rousseau, Citoyen de Genève, A Genève, 1782 ».
Le manuscrit qui a servi de base à la publication est l’original, que le fils du comte Wielhorski, Michel-Joseph, avait remis en 1804 au prince Adam Georges Czartoryski, raison pour laquelle le manuscrit se trouvait à la Bibliothèque Czartoryski de Cracovie. Du Peyrou avait toutefois conservé une copie de travail manuscrite de 87 pages recto-verso, annotée par Rousseau déposée ensuite à la Bibliothèque de Neuchâtel.(cf. Annales de la Société Jean-Jacques Rousseau T. IX 1913).
En conclusion, l’exemple de l’organisation politique et militaire de Genève mise en évidence par notre compatriote dans ses écrits politiques a indéniablement inspiré les auteurs de la Constitution polonaise du 3 mai 1791, même si ceux-ci prirent aussi exemple sur la Constituante française.
Claude Bonard
Notes 1 à 3 : Citations tirées de : Reichel Daniel, in Actes du Symposium 1987, « Jean-Jacques Rousseau et l’armée de milice dans la perspective des Considérations sur le gouvernement de Pologne », Pully, édition Centre d’Histoire et de Prospective militaires, 1989, pp.11-24.
Bibliographie :
- Eigeldinger Frédéric S. : Rousseau Jean-Jacques – Lettres sur la Suisse, Texte établi et présenté par Frédéric S. Eigeldinger, Paris-Genève, Slatkine, , coll. Fleuron, 1997, 109 p.
- Lesnodorski Boguslaw : Les Jacobins polonais, Paris, Bibliothèque d’histoire révolutionnaire ,Société des Etudes Robespierristes, en vente chez Clavreuil, Paris, 1965, 367 p.
- Reichel Daniel : in Actes du Symposium 1987, « Jean-Jacques Rousseau et l’armée de milice dans la perspective des Considérations sur le gouvernement de Pologne », Pully, édition Centre d’Histoire et de Prospective militaires, 1989, pp.11-24.
- Rousseau Jean-Jacques : Edition critique des Considérations sur le gouvernement de Pologne commentée par Michel Marty, professeur à l’Université de Paris IV Sorbonne publié dans le cadre des œuvres complètes, édition spéciale réalisée pour l’Ambassade de Suisse à Varsovie à l’occasion du tricentenaire de Rousseau et des Fêtes de la Francophonie 2012. Genève, Editions Slatkine, 2012, 140 p.
Illustration : Détail du document publié part l’ambassade de Suisse à Varsovie à l’occasion des fêtes de la Francophonie 2012.